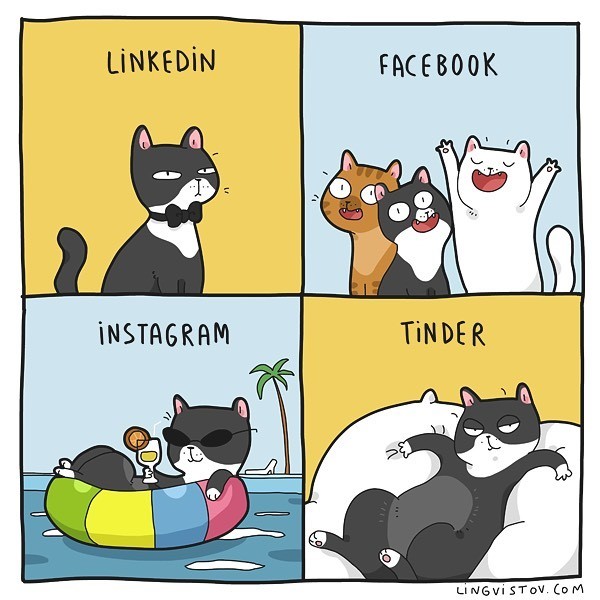Le thème de la résilience occupait déjà un certain nombre d’esprits, mais il prend une acuité toute nouvelle avec la crise sanitaire, et ce qu’elle révèle à l’échelle d’un pays et, même, d’un continent.
Nous découvrons notre vulnérabilité
Nous pensions que la résilience des continents, Etats ou cités serait affaire de montée des eaux, de méga-incendies, de sècheresses et de dimensionnement des infrastructures… Et surtout chez les autres…
Et voilà que la crise sanitaire révèle une faille profonde de résilience de nos pays occidentaux, européens notamment, à l’égard d’un tout autre ensemble de facteurs : notre approvisionnement en produits vitaux, tels que médicaux, technologiques, industriels et peut-être même, alimentaires.
Nous pensions que l’Asie du Sud-Est et l’Afrique seraient les plus touchées par l’augmentation des températures, la Chine par la pollution et les problèmes sanitaires, l’Inde, le Proche-Orient et l’Arizona par la pénurie d’eau, l’Australie et la Californie par les incendies, la Louisiane et le Mexique par les tornades, le Groenland et la Sibérie par le dégel, le Bangladesh et les iles du Tuvalu par la montée des eaux, l’Amérique Latine et l’Afrique par la disparition des forêts primaires, le Moyen-Orient par le tarissement de la manne pétrolière, le Japon par le vieillissement et qu’en outre et surtout, ce seraient les régions du monde les moins développées et les moins capitalisées qui souffriraient le plus, à cause de la fragilité de leurs infrastructures…
Et soudain, les problèmes de résilience nous concernent nous autant ou plus que les autres. Et tout de suite !
Y compris sous l’angle de la cohésion sociale… (et ici, je ne parle pas de ma cohabitation de confiné avec mon chat, évoquée dans cet autre article).
Voilà le fait nouveau : nous venons de prendre conscience de la vulnérabilité de nos économies, de nos sociétés et de nos modes de vie. C’était déjà sensible pour des raisons environnementales, mais celles-ci, pour beaucoup, restaient assez abstraites. Pour tous désormais, la fragilité de nos sociétés à nous, les nôtres précisément, est manifeste, cruelle et tangible.
Des détresses économiques profondes vont selon toute vraisemblance prolonger la crise sanitaire. Plus largement, ces difficultés sont à replacer dans un ensemble de tensions plus qu’émergentes, qu’il ne faut pas oublier : dérèglement climatique, explosion des dettes publiques, corporate et privées, inégalité jamais vue de la répartition des richesses mondiales, émergence de nouveaux régimes totalitaires alliés à des technologies intrusives, régions déstabilisées, nouveaux radicalismes…
Dans cette ère de crise tendanciellement permanente, nous nous découvrons férocement vulnérables.
Quel béat (occidental) avait annoncé la fin de l’Histoire, déjà ?
Cette vulnérabilité s’est construite derrière l’illusion de la complexité
Quelle est la « supply-chain » de Paris, de Londres, de Berlin ou d’Amsterdam ? Combien de champs et d’agriculteurs, de mines, d’usines et d’ouvriers ? Où sont-ils donc ? Combien de territoires, quelle géographie des ressources ? Où se fabrique la réponse aux consommations de nos pays, quelle est l’empreinte géographique de la chaîne d’approvisionnement de nos territoires ?
Avec la mondialisation, nous nous sommes habitués à penser que cette question était devenue relativement indémêlable et surtout, presque vaine. L’idée d’un monde lié, relié, plié, replié en un immense réseau d’échanges de composants, de sous-composants et de services nous a plongé dans l’illusion d’une subsidiarité générale du monde, où nous pourrions tous compter les uns sur les autres.
Or à l’abri de cette complexité apparente se sont opérés des mouvements de fonds très brutaux et très simples. Ce foisonnement a caché une concentration des fonctions de production dans quelques endroits du monde bien délimités et, en tout cas, pas chez nous.
Pendant que nous rêvions au monde multilatéral, en réalité celui-ci se spécialisait et se spatialisait. Certes toute mégapole est insérée dans un système d’échanges d’autant plus vaste et complexe qu’elle-même est importante. Mais la réalité est que sur la planète, les territoires industriels, qui produisent les biens, répondent aux territoires consommateurs, qui sont plutôt serviciels, et qui sont les nôtres.
C’était bien pratique : nous nourrissions l’illusion de villes et de pays propres (puisque nous délocalisions la production de nos consommations effrénées). Mais cela s’est fait au prix d’une dépendance généralisée : sanitaire, alimentaire, industrielle, technologique.
Nous avons construit des représentations éthérées de nos territoires, qui constituent un joli conte mais non pas une stratégie. C’est nous qui avons construit « l’usine du monde » qu’est la Chine, et personne d’autre.
C’est un échec. Et nous voici face à un vrai challenge économique et politique.
Quelle résilience ?

Comment donc retrouver de la résilience ? Faut-il espérer relocaliser les productions stratégiques sur le territoire d’un Etat, d’un territoire, voire d’une ville ? La demande citoyenne est forte ces jours-ci, mais est-ce efficace en termes de résilience ?
Le modèle pertinent de résilience ne me paraît pas être l’auto-suffisance. Si chaque pays, individuellement, devait reconstituer en son sein toutes les productions possibles, outre que l’objectif semble impossible à atteindre, on y gagnerait apparemment en indépendance, mais pas réellement en résilience.
La définition de la résilience est la capacité de surmonter un choc, extrême et/ou récurrent, en maintenant un fonctionnement intérieur, voire en tirant des forces nouvelles de la situation. La fable de La Fontaine « le chêne et le roseau » montre parfaitement la différence entre être « résistant » et être « résilient ». Est résilient ce qui absorbe une perturbation en se réorganisant. Ce qui est résilient n’est pas un état, mais un système capable de changer d’état. Un rocher est résistant, mais la vie est résiliente. Une psychologie humaine peut être résiliente et se reconstruire après un trauma. Une société peut être résiliente et évoluer. Pour créer de la résilience, il faut penser en systèmes adaptatifs.
Ces concepts définissent la manière de reconstruire notre résilience économique et sociétale : il s’agit de moins dépendre de ce qui ne fonctionnera pas en système avec nous, lorsque la crise surviendra.
La crise, ou la volonté de créer une pression politique…
Il s’agit donc de relocaliser les productions stratégiques non pas exactement « chez soi », mais au sein d’une communauté politique, de valeurs et d’action. Et de les faire fonctionner en réseau.
Anatomie de la résilience
Contexte sanitaire oblige, parlons d’anatomie.
Des réseaux d’approvisionnement et de production choisis et interconnectés, à l’échelle d’un ensemble politique partageant une communauté de destin et de valeurs, et des nœuds de production reconfigurables autant que possible… Voilà une définition homéostasique de la résilience. Soit : la capacité globale d’un système vivant à maintenir un ensemble de facteurs clés lui permettant de conserver l’équilibre physiologique à l’intérieur de son organisme.
Excellente définition pour une politique de la résilience : tout y est. La capacité globale, le système vivant, l’ensemble des facteurs clés, l’équilibre physiologique de l’organisme. Merci à nos soignants.
Je vois deux raisons majeures pour penser la relocalisation à l’échelle européenne. La première découle du concept même de résilience : elle ne peut être obtenue que par une pluralité de sources d’approvisionnement et la capacité de recombiner les nœuds de production. Il faut pour cela du réseau, donc de vastes communautés de citoyens et d’entreprises.
La deuxième est économique. Car derrière la fabrication des « usines du monde », il n’y a pas que des gains de coûts salariaux et environnementaux : il y a aussi les économies d’échelle. A relocaliser trop « petit », nous ne ferions que perdre la bataille du commerce.
Ne faisons pas succéder un angélisme à un autre.
Donc, quel est cet organisme au sein duquel nous visons un « équilibre homéostasique » ? L’Europe occidentale à coup sûr. Les démocraties transatlantiques certainement. Les démocraties en général, sans doute. La méditerranée, pourquoi pas. Probablement y-a-t-il plusieurs cercles concentriques.
Et quels en sont les artères et les organes ?
Les nouvelles infrastructures de la résilience

Une infrastructure, c’est traditionnellement une route, un pont, une ligne TGV, un aéroport, un port. On y intègre aussi les centrales de production d’énergie, de traitement d’eau et de déchets, les hôpitaux, les bâtiments d’enseignement, de recherche, les établissements culturels, les bâtiments publics… Cela ne concerne bien entendu pas que des constructions : on pensera aux réseaux de distribution électrique, à la fibre optique, aux data centers, aux calculateurs de météo France, aux matériels roulants, aux bornes de recharge de véhicules électriques… Et ça n’est même pas que du « dur » : l’immatériel tel que le logiciel de paie de pôle emploi, les collections virologiques de l’institut Pasteur (ainsi que le laboratoire qui les abrite), telle ou telle base de données publique de l’Insee, et même le code de nos lois, sont aussi, peu ou prou, des infrastructures.
En bref, une infrastructure, c’est tout ce qui sert une communauté, et qui se réalise ou s’exploite sous le couvert d’une régulation collective, généralement instituée.
Tout cela connaît des financements variés : publics, privés ou mixtes. Et même en crowd-funding, c’est-à-dire vous et moi.
S’il est considéré comme stratégique, pour l’homéostasie de la vie dans nos nations, que certaines productions industrielles soient relocalisées, alors elles répondent de fait à cette définition de l’infrastructure. Les investissements de la résilience industrielle à consentir demain sont bel et bien des infrastructures.
Pourtant des objets comme les usines sont traditionnellement privés, ils sont productifs de revenus marchands… Sauf si on les nationalise, mais l’histoire a prouvé que la gestion publique ne savait pas intégrer l’impératif de la performance, et que la planification publique était peu adaptative.
Je ne parle donc pas de nationaliser l’économie. J’observe pourtant que la capacité financière, la volonté et le mode de gouvernance du capital privé ne permettent pas d’espérer une relocalisation massive des productions, parce que ce n’est pas la meilleure option économique à court terme.
Pour une entreprise, délaisser une usine qui produit fort bien en Chine est presqu’impossible. Il lui faudrait simultanément consentir un nouvel investissement ici et encaisser une perte d’actif pour l’usine délaissée là-bas. C’est-à-dire, s’endetter au moment où son bilan s’est brutalement contracté. Il faudrait trouver de la main d’œuvre ici et ré-organiser toute la chaîne d’approvisionnement. Il faudrait supporter des coûts d’exploitation élevés (car si l’usine était là-bas, ce n’était pas par hasard), alors que les usines anciennes, sauf à ce qu’elles se soient démantelées toutes seules, continueront à produire. Sans parler des mesures de rétorsion.
Cela n’arrivera donc pas, sauf si l’on invente des mécanismes juridiques et financiers nouveaux. Une piste serait de considérer ces investissements productifs comme des infrastructures d’intérêt général.
C’est le principe que je tente d’explorer ci-après, avec des degrés de réalisme divers.
Propositions pour en parler…
- Déclarer d’intérêt général la reconstruction d’une supply-chain résiliente de l’économie européenne (ou du périmètre géographique que l’on se choisira). En droit français, la déclaration d’intérêt général ouvre à l’action publique le moyen de prendre le pas sur les intérêts privés qui ne joueraient pas le jeu, y compris la propriété, dès lors qu’elle les indemnise justement.
- Développer un programme de refondation de la supply-chain européenne. Les terminologies d’indépendance, de souveraineté industrielle, ou même de relocalisation nationale offrent des chatoiements un peu toxiques – il serait préférable d’analyser froidement la supply-chain européenne, et de déterminer des éléments clés : approvisionnements, molécules, processus et outils de production, savoir-faire et technologies, R&D…
- Instituer la taxe carbone aux frontières européennes : ne parlons plus de « made in X » mais de « made in charbon ». La taxe carbone aux frontières, souvent évoquée, est une manière conforme à nos valeurs multi-latérales de favoriser des productions bénéficiant d’énergies propres et nécessitant moins de transports. Ce prélèvement sur les importations, sur la base de critères environnementaux et non pas nationaux, devrait être dédié à la reconstruction de la supply-chain résiliente… Donc à travers une comptabilité distincte de celle des Etats, qui sera peut-être un jour trop proche de l’effondrement pour être vertueuse.
- Forger des zones européennes de réindustrialisation : mobiliser des clusters géographiques supra-nationaux combinant nouvelles infrastructures publiques, formation de la main d’œuvre, investissements sociétaux, soutien à la recherche et, bien sûr, nouvelles industries. En faire des zones franches totales et co-administrées entre Etats voire, même, sans aucune frontière politique. Par exemple l’ancien espace industriel de la Lorraine, la Meuse, la Sarre, la Rhur, le nord de la Belgique, où (en tout cas en France) une population et des collectivités exsangues se meurent à attendre le démarrage d’un nouveau cycle économique ?
- Planifier… La reconstruction d’une supply-chain européenne résiliente est inenvisageable sans le retour d’une planification au moins indicative et incitative. Il a pu être écrit que le 1er plan de modernisation et d’équipement français, au lendemain de la deuxième guerre mondiale (le « plan Monnet »), avait « exprimé en chiffres et traduit en actions le dilemme : modernisation ou décadence ». Cette formule n’a-t-elle pas quelque résonance aujourd’hui ? Les ressources de l’Intelligence Artificielle révolutionneraient les anciens outils de la prévision.
- Adapter les normes de pollution : je sais que cette proposition est choquante. Elle heurte profondément mes propres convictions. Pourtant, en termes environnementaux, il vaut mieux produire ici moins polluant qu’en Chine, en Inde ou autre pays à énergie carbonée. Le gain écologique serait majeur et ce, même si nous acceptions transitoirement des normes moins contraignantes que nos standards habituels. Réfléchissons bien à ce qui nous hérisse dans cette proposition (qui me hérisse moi-même) : c’est notre confort qui s’y oppose, et non un raisonnement environnemental. L’écologie comme qualité de vie ici achetée au prix de pollutions accélérées lointaines, c’est une hypocrisie…
- Ré-introduire, par le financement, le long terme et l’intérêt stratégique dans l’investissement productif. Introduire dans le financement des projets, au côté des fonds propres privés, des financements très longs de type obligataire garantis par les Etats, avec remboursement in-fine. Le modèle de l’emphytéose, qui peut aller jusqu’à 99 ans, est un classique intéressant.
- Mettre en œuvre des structures juridiques d’investissement nouvelles de compétence élargie : elles auraient pour mission de financer voire porter les infrastructures de la résilience au sens large : infrastructures de desserte, énergie, coques des immeubles industriels, machines et process, formation… Elles véhiculeraient les financements spéciaux indiqués au point précédent. Doivent-elles appartenir à l’économie mixte ? Cela peut paraître une bonne idée, mais en prenant garde à la confrontation des cultures publique et privée, qui en rend la gouvernance très problématique. Mon expérience déconseille malheureusement la présence de l’Etat ou de ses agences, qui se conçoivent comme la seule incarnation légitime de l’intérêt général, tandis que les collectivités locales et régionales paraissent plus proches du terrain et moins dominatrices.
- Elaborer des partenariats trans-continentaux nombreux, dans ces « cercles concentriques » de « l’organisme homéostasique » évoqués plus haut.
- Edicter une affirmation politique constituante : enfin, ne faudrait-il pas ré-affirmer ce qui « fait système » pour nous, et nous sépare fondamentalement des nouveaux régimes totalitaires alliées aux technologies (de l’information, et d’autres demain) : par exemple, le droit humain fondamental à la vérité, sans lequel il n’y a pas de libre-arbitre possible.
Le confinement nous permet de réfléchir, de prendre du recul. Parfois, c’est drôle (c’était l’idée de l’anecdote du chat…), parfois un peu plus sérieux…
De tous temps, la résilience a été un combat. Je crains que la partie ne soit en train de recommencer… Heureusement nous avons gardé vivace, espérons-le, notre capacité d’innovation et d’adaptation. C’est bientôt la relance post-confinement… Et voici donc le moment de poser sérieusement le sujet.